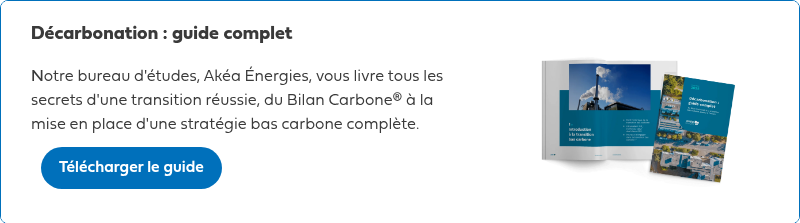Les puits de carbone jouent un rôle essentiel dans la régulation climatique de notre planète. Leur développement, mais aussi la préservation des puits naturels sont essentiels pour limiter le réchauffement climatique. La gestion des puits de carbone fait d’ailleurs partie des leviers identifiés pour atteindre l’objectif de neutralité carbone de l’Union européenne. Cet article revient sur la définition d’un puits de carbone, sur les principaux types de puits, ainsi que sur les moyens de les préserver.
Qu’est-ce qu’un puits de carbone ?
Un puits de carbone est un système naturel ou artificiel capable de capter et de stocker plus de dioxyde de carbone (CO2) qu’il n’en émet. Ce phénomène de séquestration carbone participe à la régulation des concentrations de CO2 des 4 grands réservoirs naturels, à savoir :
- L’hydrosphère ;
- La lithosphère ;
- La biosphère ;
- L’atmosphère.
L’augmentation et la sécurisation des puits de carbone français font partie des leviers identifiés par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) pour limiter le réchauffement climatique.
Dans le contexte du réchauffement climatique, les puits de carbone ont un rôle encore plus important à jouer. En stockant des quantités importantes de dioxyde de carbone, ils diminuent son niveau de concentration dans l’atmosphère. L’effet de serre produit est alors – au moins temporairement – plus faible, et le rythme du changement climatique ralentit.
Quelle est la différence entre un stock de carbone et un puits de carbone ?
Il est très important de ne pas confondre les notions de puits de carbone et de stock de carbone. Un puits de carbone correspond à un réservoir qui absorbe davantage de carbone qu’il n’en émet. Cette notion est donc directement liée aux flux de carbone annuels auxquels il participe. De plus, on considère qu’un puits doit stocker ce carbone supplémentaire sur une durée de temps relativement étendue.
Dans son avis sur la neutralité carbone, l’ADEME donne l’exemple de la production agricole de maïs. Elle absorbe une certaine quantité de CO2 par photosynthèse pendant la pousse, mais la rejette rapidement dans l’atmosphère après la récolte. Au vu de ce temps de stockage relativement court, les plants de maïs ne peuvent donc pas être considérés comme des puits de carbone. Cette illustration montre pourquoi il est important de parler de séquestration carbone, lorsqu’on évoque l’absorption de CO2 par un puits.
Un stock de carbone correspond simplement à la quantité de carbone contenue dans un réservoir de carbone à un moment donné. On prend généralement en compte la moyenne annuelle, ou sur plusieurs années. En résumé : ce n’est pas parce qu’un réservoir dispose d’un grand stock de carbone qu’il constitue un puits de carbone tout aussi important. Les flux de carbone sont la principale donnée à examiner pour déterminer quels réservoirs sont effectivement des puits, et quelles quantités ils absorbent chaque année.
Quels sont les différents puits de carbone naturels ?
De nombreux écosystèmes participent à la régulation de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Différents processus naturels permettent l'absorption de ce GES (gaz à effet de serre). Le principal est la photosynthèse, utilisée par les forêts, le phytoplancton, le bocage ou encore les marais côtiers. Mais certains puits de carbone naturels, comme l’océan, utilisent également d’autres mécanismes. Voici une petite introduction aux 3 puits de carbone naturels les plus importants.
Les océans : premier puits de carbone au monde
Couvrant plus de 70 % de la surface de la planète, les océans constituent le plus important puits de carbone mondial. Pour absorber le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère, il utilise :
- Des processus biologiques : le phytoplancton océanique capte le CO2 de l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Après de nombreuses transformations dues à la chaîne alimentaire, une partie du carbone piégée dans les débris organiques chute dans les couches profondes de l’océan.
- Des processus physico-chimiques : grâce au refroidissement des eaux de surface aux hautes latitudes, le CO2 atmosphérique est dissous, puis emporté dans les profondeurs de l’océan.
Au-delà du carbone qu’il absorbe chaque année, l’océan constitue un immense stock de carbone. Il contient ainsi près de 50 fois plus de carbone que l’atmosphère.
C’est la quantité approximative des émissions anthropiques (générées par les activités humaines) que l’océan mondial aurait absorbée entre 2008 et 2017, selon le Global Carbon Budget de 2018.
Les forêts : l’autre poumon de la planète
Les forêts constituent le deuxième plus grand puits de carbone mondial, après l’océan. Tout comme le plancton océanique, les forêts procèdent à l’absorption du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Différents éléments de la biomasse forestière contribuent à la captation du CO2.
On divise le réservoir de carbone de la forêt en 4 stocks distincts :
- La biomasse vivante, composée de la biomasse aérienne (branches d’arbres, graines, feuillage, etc.) et de la biomasse souterraine (racines) ;
- La matière organique du sol forestier ;
- Le bois mort ;
- La litière.
La biomasse vivante et la matière organique du sol constituent les principaux stocks de carbone de la forêt.
Il s’agit de l’estimation de la quantité d’équivalent de CO2 nette absorbée par les forêts en France (Hexagone et Outre-mer UE) en 2024, d’après le Citepa.
Les sols et les sous-sols : un puits de carbone moins connu
Les sols et les sous-sols constituent un autre puits de carbone très important. Le stockage du carbone se fait de manière similaire à l’océan et aux forêts. Les plantes absorbent directement une partie du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère par photosynthèse. Les végétaux et autres matières organiques en décomposition vont ensuite se stocker dans les sols et les sous-sols.
Tous les types de sols ne sont évidemment pas égaux dans leur capacité à absorber et à stocker du dioxyde de carbone. Certains sols, comme les prairies, sont bel et bien des puits de carbone. D’autres, comme les terres cultivées ou les zones artificialisées, constituent en revanche des sources d’émissions de gaz à effet de serre.
Au-delà des flux de carbone qu’ils absorbent ou émettent chaque année, les sols constituent des stocks de carbone massifs. Le carbone piégé dans les sols classiques – ainsi que dans le permafrost – est bien plus important que celui stocké dans les forêts.
Il s’agit de l’estimation de la quantité d’équivalent CO2 nette absorbée par les prairies françaises en 2024 (Hexagone et Outre-mer UE), selon le Citepa.
Quels sont les différents puits de carbone artificiels ?
Devant le défi immense que représente le ralentissement du réchauffement climatique, des puits de carbone artificiels ont vu le jour. On parle de technologies de capture, stockage et valorisation du carbone (le sigle utilisé venant de l’anglais est CCUS). Ces dernières ont été développées pour compléter les capacités des puits de carbone naturels.
Le captage et stockage du CO2 (CCS en anglais) constitue le principal type de puits de carbone artificiel. Cette pratique consiste à capter le dioxyde de carbone émis par certaines industries très polluantes. On le stocke ensuite à plus de 1 000 m de profondeur, dans des réservoirs étanches. Certaines technologies visent à valoriser le carbone au lieu de l’enfouir dans le sous-sol. On appelle cette pratique le captage et utilisation (ou valorisation) du CO2 (CCU en anglais). On peut, par exemple, réutiliser le carbone comme intrant dans la fabrication de certains produits.
Si ces technologies sont intéressantes, elles sont la cible de nombreuses critiques. Il s’agit tout d’abord de solutions très coûteuses. De plus, les puits de carbone technologiques nécessitent l’utilisation de nombreuses ressources. Ces projets eux-mêmes émettent donc des émissions de gaz à effet de serre et contribuent au changement climatique. Plus largement, la plupart des solutions de puits de carbone artificiels semblent encore assez peu matures et leur impact environnemental n’est pas suffisamment connu.
Quelles sont les limites des puits de carbone naturels ?
Les puits de carbone naturels importants ne disposent pas d’une capacité de stockage illimitée. Les flux de carbone absorbés chaque année sont directement liés à l’état de santé des écosystèmes, eux-mêmes impactés par le changement climatique et ses conséquences. Les sécheresses, les incendies et la déforestation réduisent par exemple le puits de carbone des forêts. Du côté de l’océan mondial, l'acidification des masses d’eau et l’augmentation de la température de l’eau réduisent sa capacité à absorber du CO2.
Comme on peut le voir, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère impacte les écosystèmes. L’efficacité des puits de carbone naturels diminue, ce qui fait encore plus augmenter la quantité de GES qui reste dans l’atmosphère. Ce type de phénomène est ce qu’on appelle une « boucle de rétroaction positive ». Ces boucles n’ont évidemment de positif que le nom, puisqu'elles accélèrent progressivement le rythme du réchauffement climatique.
En plus des boucles de rétroactions, d’autres actions humaines ont des conséquences sur la qualité des puits de carbone. À titre d’exemple, l’artificialisation des terres ou leur utilisation pour l’agriculture réduisent fortement le puits de carbone des sols.
D’après le rapport Secten 2024, le secteur UTCATF (Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Forêts) a absorbé 21 Mt d’équivalent CO2 de moins que l’objectif fixé par le budget carbone 2019-2023 de la France. Cet écart important avec les prévisions est principalement dû à l’effondrement du puits de carbone des forêts ces dernières années.
Comment préserver les puits de carbone naturels ?
La préservation des puits de carbone naturels constitue un enjeu fondamental pour freiner le réchauffement climatique. Il s’agit bien entendu de conserver leur capacité à absorber plus de CO2 qu’ils n’en émettent chaque année. Mais il est aussi nécessaire d’éviter que certains écosystèmes disposant de grands stocks de carbone ne se transforment en sources d’émission majeures.
Adopter des solutions durables pour préserver la capacité des écosystèmes à absorber du carbone
Pour préserver, restaurer et développer les puits de carbone naturels, il est possible de mettre en place différentes mesures. Chaque écosystème a ses propres besoins pour rester en bonne santé et poursuivre sa mission de captation du carbone. Réduire l’artificialisation des sols, le retournement des prairies et la suppression des zones humides permettrait de préserver le puits de carbone des sols.
Adopter des pratiques agricoles plus durables est aussi un levier intéressant. Il peut s’agir, par exemple, de mettre en place un couvert végétal des sols tout au long de l’année. Limiter la déforestation et œuvrer pour une gestion forestière plus durable est évidemment une priorité pour préserver les forêts.
Suivre des bonnes pratiques lors du financement de projets de contribution carbone
Il est difficile de parler de puits de carbone sans évoquer la contribution carbone – ou compensation carbone. Il s’agit pour les entreprises de financer des projets de décarbonation séparés de leurs propres activités. Or, un grand nombre des actions de transition de ce marché concernent la séquestration carbone. Pour les puits naturels, on pense évidemment en premier lieu aux projets de reforestation, largement médiatisés.
Afin de s’assurer d’avoir un impact positif lors de l’achat de crédits carbone, l’ADEME propose aux entreprises de suivre 5 bonnes pratiques pour réussir leur compensation carbone.
La qualité de ces projets est très variable et cette pratique peut soulever de nombreuses questions éthiques et environnementales. C’est pourquoi il est indispensable d’être particulièrement vigilant, lors de l’achat de crédits carbone. Mais quels que soient les moyens de contribution carbone employés, ils ne doivent jamais se substituer à la réduction des émissions de GES.
Limiter le développement des boucles de rétroaction en accélérant la diminution des émissions
Comme nous l’avons vu, des boucles de rétroactions accélérant le réchauffement climatique et impactant la qualité des puits de carbone sont déjà l’œuvre. Mais les conséquences d’une dégradation des écosystèmes pourraient s’avérer beaucoup plus graves qu’une simple perte d’efficacité. Certains réservoirs contiennent des quantités très importantes de carbone.
Une accélération du réchauffement climatique pourrait mener à la libération de ces stocks de carbone dans l’atmosphère. On peut citer le cas très connu de la fonte du permafrost (pergélisol en français). La décomposition rapide des matières organiques gelées pourrait libérer des quantités importantes de CO2 et de CH4 (méthane).
Ceci créerait une nouvelle boucle de rétroaction positive, accélérant rapidement le réchauffement climatique. Devant le risque de multiplication de ces boucles, il est indispensable de réduire urgemment les émissions de GES au niveau mondial.
À lire aussi : tout savoir sur la comptabilité carbone