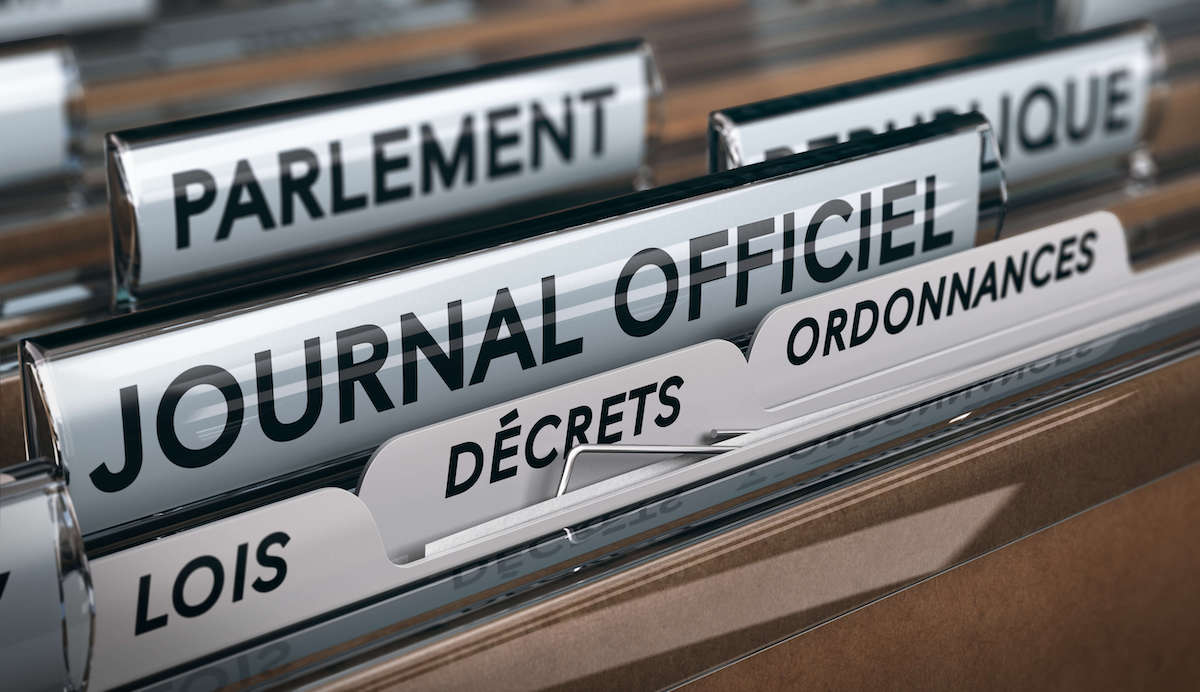L’achat de crédits carbone fait partie des leviers de transition les plus mis en avant par les entreprises. Pourtant, les marchés de la compensation carbone volontaire et de conformité font face à de nombreuses critiques depuis leur création. Pour comprendre les enjeux associés à ce type de financement, il est essentiel de bien saisir le fonctionnement et les limites des crédits carbone. Définition, critères d’attribution, critiques : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ces célèbres certificats.
Qu’est-ce qu’un crédit carbone ?
Un crédit carbone est un certificat représentant la séquestration ou l’évitement d’une tonne d’équivalent CO2 émise dans l’atmosphère. Un projet de décarbonation peut, sous certaines conditions, générer un nombre de crédits carbone correspondant à son impact estimé. La commercialisation de ces certificats doit ensuite servir à financer ou à rémunérer les actions d’évitement ou de séquestration.
Il existe deux types de crédits carbone :
- Les crédits ex-ante ;
- Les crédits ex-post.
Les crédits ex-ante sont délivrés avant la mise en place du projet. La quantité de crédits carbone générés correspond alors à l’estimation des performances futures du programme. À l’inverse, les crédits ex-post sont générés après la mise en œuvre des actions de décarbonation. La quantité de crédits carbone émis est donc beaucoup plus fiable, puisque l’évitement ou la séquestration du carbone a déjà eu lieu.
Quels sont les différents marchés de crédits carbone ?
Il existe deux types de marchés du carbone permettant d’acheter des crédits. Voici ce qu’il faut retenir sur chacun d’entre eux.
1 – Les marchés de conformité
Les marchés de conformité constituent des marchés « officiels » qui imposent des règles strictes quant aux crédits carbone émis. Ils sont créés dans le cadre d’une législation régionale, nationale ou internationale, afin de servir les objectifs de réduction des émissions du territoire concerné.
Un crédit carbone émis dans un marché de conformité permet aux acteurs devant respecter des plafonds d’émission de « compenser » leur surplus de GES (gaz à effet de serre). Si une entreprise ou un État émet 100 tonnes de CO2eq en trop sur une année, elle peut ainsi respecter ses engagements en achetant 100 crédits carbone.
Il est important de ne pas confondre les crédits carbone du marché de conformité et les systèmes d’échange de quotas d’émissions (SEQE). Les quotas carbone correspondent à des « droits à émettre » au sein d’un secteur d’activité, d’un territoire ou encore d’un espace économique. Chaque acteur concerné se voit allouer un certain nombre de quotas à utiliser. Une organisation ou un État qui émet moins que sa limite imposée peut alors vendre ses quotas restants à des acteurs qui ont dépassé leur plafond.
L’exemple le plus connu de marché de conformité concerne deux des mécanismes du Protocole de Kyoto, à l’origine même du concept de crédit carbone :
- Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) consistant à commercialiser des crédits carbone pour financer des projets de décarbonation dans des pays en développement.
- La Mise en Œuvre Conjointe (MOC), dont les crédits carbone servaient exclusivement à financer des projets réalisés dans les États de l’Annexe 1 qui ont ratifié le protocole.
Ces mécanismes ne permettent plus la certification de nouveaux projets, depuis la fin de la seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto, en 2020. Cependant, un nouveau marché de conformité international va leur succéder, dans le cadre de l’Accord de Paris. Il s’agit du Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM), qui relève de l’article 6.4 de l’accord. Un transfert de certification du mécanisme MDP est d’ailleurs prévu.
2 – Le marché volontaire du carbone
Le marché volontaire du carbone a vu le jour après la mise en place des mécanismes du Protocole de Kyoto. L’objectif était de répondre à une demande des entreprises non concernées par les marchés de conformité ou souhaitant aller plus loin que leurs obligations. En d’autres termes, les marchés volontaires du carbone sont ouverts à tous les acteurs. Les entreprises, mais aussi les collectivités, les associations ou encore les individus peuvent acheter des crédits carbone.
Si aucune législation ne les encadre, la plupart des crédits carbone volontaires sont émis par quelques grands labels de compensation carbone. Ces entités créent des standards encadrant l’allocation de crédits carbone à un projet. On peut citer les standards privés Verified Carbon Standard (VCS) de Verra, le Gold Standard ou encore le Label bas-carbone (label public français).
Quels critères permettent l’attribution de crédits carbone ?
Les 5 principaux critères permettant d’émettre des crédits carbone via un label volontaire connu sont les suivants :
- L’additionnalité : la séquestration ou l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre doivent être additionnels. Cela signifie que cette décarbonation n’aurait pas pu avoir lieu sans la mise en place du projet de compensation.
- La permanence : la séquestration des GES ou l’évitement de leur émission doit s’inscrire sur le long terme. La durée minimum d’action dont il faut pouvoir justifier est généralement de 7 ans.
- La mesurabilité : la quantification des émissions de GES réduites, évitées ou séquestrées doit être possible selon une méthode reconnue.
- La vérifiabilité : les performances du projet de compensation carbone doivent pouvoir être vérifiées par un auditeur indépendant et compétent.
- L’unicité : les crédits carbone relatifs à un projet de compensation doivent être inscrits sur un registre unique, afin d’éviter la double comptabilisation.
Bien entendu, chaque standard de compensation carbone impose ses propres prérequis. Ces derniers varient en fonction du niveau d’exigence de l’organisation qui les administre, mais aussi selon la nature des projets visés.
À lire aussi : tout savoir sur la comptabilité carbone
Comment acheter des crédits carbone ?
Pour acheter des crédits carbone, une entreprise ou tout autre acteur peut directement entrer en contact avec des porteurs de projets de décarbonation. Une autre possibilité consiste à trouver des crédits carbone sur les marketplaces des standards de compensation ou sur des plateformes tierces.
L’achat de crédits carbone ne permet pas de réduire les émissions calculées dans le cadre de son bilan carbone.
Mais si ces achats directs sont bien possibles, les organisations choisissent généralement de passer par un opérateur. Spécialiste de la compensation carbone, cet organisme sert d’intermédiaire entre les financeurs et les projets.
Ce type de transaction indirecte est particulièrement adapté aux acteurs qui manquent d’expertise pour bien sélectionner les projets à financer. Une fois les crédits carbone achetés, il est nécessaire de déclarer leur acquisition sur le registre qui les recense. Les crédits sont alors retirés du registre, afin qu’ils ne puissent pas être revendiqués par un autre acteur.
Quel est le prix d’un crédit carbone ?
En 2023, le prix moyen d’un crédit carbone acquis par un acheteur français sur le marché volontaire était de 8,05 €, selon la plateforme Contribution Neutralité Carbone. Les prix proposés pour la séquestration ou l’évitement d’une tonne de CO2eq sont cependant très variés. Selon la même étude de la plateforme, le prix minimum recensé en 2023 était de 0,38 € et le prix maximum de 205 €.
Les crédits carbone issus du MDP du Protocole de Kyoto qui n’ont pas été achetés sur le marché de conformité peuvent aujourd’hui être vendus sur le marché volontaire.
En effet, de nombreux facteurs peuvent considérablement influencer le prix d’un crédit carbone. On peut notamment citer :
- La certification associée au crédit carbone : plus un crédit est délivré dans le cadre d’un standard rigoureux, plus il a de la valeur. Les crédits Label bas-carbone affichaient un prix moyen de 34,48 € en 2023 contre seulement 3,43 € pour les crédits MDP.
- La localisation géographique du projet de décarbonation : le pays dans lequel un projet est porté impacte fortement la valeur de ses crédits carbone. Cela s’explique par une différence du coût de la main-d’œuvre, par la taille des projets, mais aussi par le niveau de transparence et de contrôle associé.
- Le type de projet de compensation carbone : les crédits issus de projets de séquestration carbone via le développement de puits de carbone sont beaucoup plus coûteux que ceux visant l’évitement de potentielles émissions. Plus largement, la nature d’un projet influe sur son coût, et donc sur le prix des crédits carbone associés.
D’autres facteurs impactent le coût des crédits carbone. Les co-bénéfices d’un projet de décarbonation, le nombre d’intermédiaires entre l’acheteur et le porteur de projet ou encore le volume de crédits achetés en sont des exemples.
Concernant le marché de conformité international de l’Accord de Paris, aucune réglementation encadrant les prix des crédits carbone n’est prévue à ce jour. Appelés « A6.4ERs » (Article 6.4 Emission Reductions), la valeur de ces crédits sera elle aussi soumise à l’offre et à la demande.
Quelles sont les limites des crédits carbone ?
Depuis la création des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto jusqu’à l’essor du marché volontaire, les crédits carbone ont toujours suscité de vifs débats. Le risque de greenwashing et le manque de fiabilité des méthodologies de calcul et de suivi des émissions constituent les principales critiques.
La compensation carbone et l’éco-blanchiment
Le premier procès fait aux crédits carbone est parfaitement reflété par l’expression de « compensation carbone ». De nombreuses entreprises préfèrent investir massivement dans des crédits carbone bon marché pour avancer des allégations de neutralité carbone, plutôt que de décarboner leurs propres activités. Dans ce contexte, le crédit carbone devient davantage un outil de greenwashing qu’un réel engagement écologique. C’est pourquoi le terme de contribution carbone tend à remplacer celui de compensation carbone.
L’utilisation de la norme ISO 14021 peut aider les organisations à communiquer de façon plus responsable sur leurs projets de compensation carbone.
Comme le rappelle cet article de Carbone 4, la réduction des émissions et le financement de projets en dehors de sa chaîne de valeurs sont des leviers différents et non fongibles.
Réduire ses émissions de gaz à effet de serre doit être la priorité numéro une de tous les acteurs de la transition. Pour les organisations disposant de ressources suffisantes, il peut être intéressant de compléter leur action en finançant des projets via l’achat de crédits carbone de qualité.
Une estimation des émissions évitées très complexe
La deuxième grande critique faite aux crédits carbone concerne leur manque de qualité et de fiabilité. Ces dernières années, de nombreux scandales ont entaché la confiance des acheteurs envers le marché des crédits carbone. On peut notamment citer cette enquête réalisée en 2022 par The Guardian, Die Zeit et SourceMaterial. L’investigation avait révélé que 94 % des crédits carbone issus du plus gros label « REDD+ » (Verra) n'avaient soit aucun impact réel ou que les chiffres étaient largement surestimés.
Depuis, les méthodologies en question ont été mises à jour. Mais la crise de confiance est loin d’être finie. Les standards de compensation carbone doivent continuer à améliorer leurs méthodes d’attribution de crédits carbone pour mieux refléter la réalité. De leur côté, les entreprises et les autres acteurs ont une responsabilité : celle d’être plus vigilant sur les crédits carbone achetés et les projets financés.
Comment choisir quels crédits carbone acheter ?
Bien choisir quels crédits carbone acheter pour avoir un impact réel sur le climat est loin d’être évident. Plusieurs bonnes pratiques permettent cependant de maximiser ses chances de participer efficacement à la transition bas carbone. Voici quelques conseils pour mieux sélectionner ses projets de compensation.
Choisir des crédits carbone issus d’un label de qualité
Il est essentiel de favoriser les crédits carbone provenant des meilleurs labels de compensation. Certains standards sont plus généralistes, tandis que d’autres sont spécialisés dans un type de projet, comme la reforestation. Il convient donc de se renseigner sur les labels les plus rigoureux, selon le type d’action envisagé.
Certains programmes peuvent bénéficier de reconnaissances indépendantes de leur niveau de qualité. Les labels conformes au CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ou encore au label CCP de l’ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) sont, par exemple, réputés plus fiables.
Au-delà des principaux labels de compensation carbone, un projet peut bénéficier de standards complémentaires (ex : CCB Standards, Social Carbon Standard). Ces programmes visent notamment à certifier la présence de co-bénéfices d’une action, en plus de la réduction des émissions de GES.
Privilégier les projets de séquestration carbone pour une meilleure fiabilité des crédits
Il est plus facile d’estimer les gaz à effet de serre séquestrés par un projet que les émissions potentiellement évitées. En effet, les projets d’évitement se basent sur des scénarios de référence plus ou moins fiables pour calculer leur impact. Une entreprise qui souhaite que chaque crédit carbone acheté se rapproche le plus possible de la tonne de CO2 devrait se tourner vers les projets de séquestration.
Lorsque cela est possible, il est conseillé de préférer l’achat de crédits carbone ex-post.
La Net Zero Initiative préconise, par ailleurs, de distinguer une troisième catégorie de projet : la réduction d’émissions par rapport à une situation antérieure. Ce type de démarche permet une comparaison claire avec un bilan carbone passé.
L’estimation du nombre de crédits carbone à allouer est donc de meilleure qualité que pour une démarche d’évitement des émissions basée sur un scénario de référence.
Se faire conseiller pour choisir les meilleurs crédits carbone
Devant la complexité actuelle du marché des crédits carbone, il est souvent utile d’être accompagné pour faire le bon choix. Pour contribuer à un réel impact climatique positif, les entreprises doivent cependant être claires sur leurs valeurs et rester fermes sur le niveau de qualité des projets soutenus. Cela vaut pour l’intégrité des crédits carbone en elle-même, mais aussi pour les co-bénéfices sociaux et environnementaux des différentes démarches.