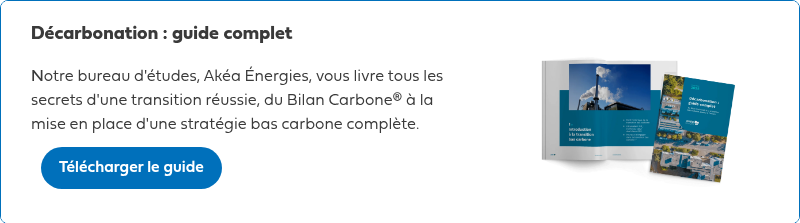Les politiques de décarbonation des États et des entreprises s’inscrivent dans des objectifs communs, définis notamment par l’Accord de Paris. Il s’agit non seulement de maintenir le réchauffement climatique mondial bien en dessous des 2 °C, mais aussi de parvenir à la neutralité carbone globale avant la fin du siècle. Cet article revient sur la définition de la neutralité carbone, sur les objectifs associés et les moyens pour les atteindre, ainsi que sur les trajectoires de décarbonation actuellement envisagées.
Qu’est-ce que la neutralité carbone ?
La neutralité carbone constitue un état d’équilibre entre les gaz à effet de serre (GES) émis dans l’atmosphère et ceux qui sont absorbés et séquestrés par les puits de carbone. Dans cette situation, le taux de concentration de gaz à effet de serre reste stable dans l’atmosphère. La neutralité carbone implique donc un plafonnement de l’effet de serre produit par les GES et de son effet sur le climat. Pour le dire simplement, cet état permet de stopper le réchauffement climatique.
Le terme de neutralité carbone est parfois remplacé par l’expression « zéro émission nette » (ou « net zero », en anglais)
Atteindre la neutralité carbone suppose de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c’est-à-dire causées par les activités humaines. La quantité annuelle d’émissions restantes doit correspondre à la capacité d’absorption annuelle collective des puits de carbone. Ces réservoirs, naturels ou artificiels, ont la capacité de stocker le carbone absorbé pendant de longues périodes. On parle de séquestration du carbone.
Quels sont les objectifs associés à la neutralité carbone ?
Atteindre la neutralité carbone et stopper l’aggravation du dérèglement climatique constitue un objectif à part entière. Bien qu’elle ne soit pas nommée ainsi, la neutralité carbone est d’ailleurs présentée comme l’une des cibles de l’Accord de Paris, dans son article 4. Le texte, adopté en 2015 par la plupart des pays du monde, vise la neutralité carbone mondiale « au cours de la deuxième moitié du siècle ».
Mais cet état d’équilibre constitue aussi un prérequis pour parvenir aux autres objectifs de l’Accord. Pour rappel, ce traité international vise à limiter le réchauffement planétaire bien en dessous de 2 °C, par rapport aux niveaux pré-industriels. Or, pour valider que les températures mondiales ont bien été limitées, il faut nécessairement que la concentration de GES dans l’atmosphère soit stabilisée. Le zéro émission nette – maintenu sur le long terme – est donc indissociable des autres cibles de transition bas carbone.
Suite à l’Accord de Paris, certaines Parties signataires ont pris des engagements supplémentaires. L’Europe, dans le cadre du Green Deal, vise à réduire ses émissions de 55 % d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Dans le reste du monde, les objectifs fixés par les différents États sont variables. Certains grands pays, comme le Canada, le Brésil ou l’Australie, visent également la neutralité carbone en 2050. La Chine et l’Arabie Saoudite souhaitent atteindre le zéro émission nette en 2060, tandis que l’Inde se donne jusqu’en 2070.
L’Accord de Paris, bien que contraignant, ne propose pas de mécanisme coercitif poussant les États à agir, ou de sanctions en cas de non-respect de leurs engagements.
Quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre la neutralité carbone ?
Au niveau mondial, l’objectif de neutralité carbone s’appuie sur différents mécanismes mis en œuvre dans le cadre de l’Accord de Paris. Voici ce qu’il faut retenir sur les moyens internationaux existants, ainsi que sur la stratégie de transition française.
Les outils de l’Accord de Paris pour atteindre ses objectifs
Chaque pays est tenu de soumettre un plan d’action climatique tous les 5 ans. Ces contributions nationales déterminées (NDC) présentent des actions de réduction des émissions de GES, mais aussi les stratégies d’adaptation au changement climatique des États. L’Accord de Paris fournit également un cadre favorisant la coopération internationale sur les sujets financiers, technologiques et de renforcement des capacités. L’objectif est notamment d’aider les pays en développement à faire face aux défis de la transition climatique et à participer à l’effort collectif.
Depuis 2024, les Parties signataires de l’Accord de Paris doivent rendre compte de manière transparente de leurs progrès réalisés, des actions entreprises et de l’aide internationale apportée ou reçue.
L’Accord de Paris encourage aussi la soumission de stratégies de transition de long terme (LT-LEDS). Communément appelées stratégies bas-carbone 2050, ces feuilles de route facultatives ont pour objectif de consolider les NDC dans une vision à long terme. La France fait partie des pays ayant soumis une LT-LEDS, sous la forme de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC).
Les grands axes de la Stratégie nationale bas-carbone en France
La France a créé sa Stratégie nationale bas-carbone en 2015. Cette feuille de route, révisée tous les 5 ans, s’appuie sur des budgets carbone, qui couvrent également des périodes de quinquennat. Un budget carbone constitue un plafond d’émissions de GES à ne pas dépasser, et est exprimé en moyenne annuelle sur sa période de référence. On retrouve des budgets pour chaque grand secteur, mais aussi pour chacune des principales catégories de gaz à effet de serre.
En complément de la SNBC, la stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) se base sur deux autres feuilles de route pour atteindre ses objectifs de transition bas carbone. Il s’agit de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC).
Les budgets carbone permettent de créer des objectifs intermédiaires et actualisés pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sur le territoire national. Chaque année, ils sont comparés avec les émissions de gaz à effet de serre réellement générées et constituent les principaux indicateurs de suivi de la stratégie française. Pour respecter ces budgets, la Stratégie nationale bas-carbone met en évidence plusieurs actions prioritaires, comme :
- réduire la consommation d’énergie, en particulier fossile ;
- augmenter fortement la production d’énergie bas carbone pour répondre à des besoins croissants ;
- mobiliser la biomasse de façon responsable, notamment pour les besoins énergétiques et la construction ;
- décarboner le numérique et le mettre au service de la transition bas carbone ;
- promouvoir une utilisation économe de l’espace et limiter l’artificialisation des sols ;
- augmenter la résilience du puits de carbone forestier aux effets du changement climatique.
Plus largement, la SNBC, dont la troisième itération doit être validée courant 2025 (SNBC-3), s’adresse à tous les acteurs. Elle précise que la mobilisation conjointe de l’État, des collectivités, des entreprises et des citoyens est indispensable pour parvenir à la neutralité carbone et s’adapter au changement climatique.
Dans quelle trajectoire de décarbonation la planète se trouve-t-elle actuellement ?
D’après un rapport de 2024 du Centre commun de recherche (JRC) de l’Union européenne, les émissions de GES mondiales ont augmenté d’environ 1,9 % entre 2022 et 2023. Dans tous les scénarios étudiés, les émissions mondiales devraient atteindre leur pic dans les prochaines années, avant de commencer à baisser progressivement. Notons que parmi les 6 plus grandes économies mondiales, seules l’UE et les États-Unis d’Amérique ont connu une baisse de leurs émissions en 2023.
Selon l’Emissions Gap Report 2024 du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les mesures actuelles des pays du monde sont largement insuffisantes pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. En conservant les politiques actuellement en place, le monde suivrait une trajectoire d’augmentation des températures qui atteindrait environ 3,1 °C en 2100. Si les pays ayant des plans d’action climatique (NDC) mettent en place toutes les mesures annoncées, ce réchauffement pourrait être limité autour des 2,6 °C.
À lire aussi : tout savoir sur la comptabilité carbone
La poursuite de la neutralité carbone en France et en Europe
En France, le budget carbone national pour la période 2019-2023 fixé par la SNBC-2 a bien été respecté. Cependant, le rythme de réduction des émissions s’est largement ralenti en 2024, avec une baisse de seulement 1,8 % des émissions, par rapport à 2023 (hors UTCATF). Les premières estimations de 2025 montrent même une stagnation des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Or, pour respecter les budgets carbone temporaires de la SNBC-3, le rythme de réduction des émissions doit doubler, par rapport à 2024.
Du côté de l’Union européenne, le rythme de réduction des émissions de GES est clairement insuffisant pour atteindre les objectifs de 2030 et de neutralité carbone en 2050. D’après l’Agence européenne pour l’environnement, les politiques actuelles des États membres conduiraient à une réduction de seulement 43 % des émissions en 2030. Même en prenant en compte certaines mesures additionnelles, l’UE réduirait ses émissions de GES de 49 %, loin de la cible des 55 %.
Cet écart entre les cibles fixées et les scénarios actuels devient plus important dans les décennies suivantes. Cette trajectoire comprenant des mesures additionnelles conduirait à une réduction d’environ 66 % des émissions de l’UE en 2050. Or, pour atteindre la neutralité carbone au niveau européen, l’objectif est de réduire les gaz à effet de serre émis de 90 %. Il est donc urgent pour les pays de l’UE de rehausser l’ambition de leurs plans de transition.
Comment participer à l’objectif de neutralité carbone pour une organisation ?
Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone au niveau national, européen et mondial, les organisations publiques et privées ont un rôle majeur à jouer. Voici quelques-unes des démarches qu’il est possible d’entreprendre pour contribuer à la neutralité carbone globale et à la transition de son secteur d’activité.
Le bilan carbone : calculer ses émissions pour mieux les réduire
La première étape de la stratégie de transition d’une entreprise ou d’une collectivité consiste généralement à réaliser un bilan carbone. Il s’agit d’estimer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre générée par les activités de l’organisation sur un périmètre organisationnel, opérationnel et temporel donné.
Le référentiel Net Zero Initiative, porté par le cabinet de conseil Carbone 4, constitue une excellente ressource pour les organisations souhaitant participer à l’objectif de neutralité.
Faire un bilan carbone rigoureux en suivant une méthodologie reconnue permet de catégoriser ses sources d’émission et d’analyser l’impact de chacune de ses activités. Il est important de noter qu’un bilan carbone se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi il peut être intéressant de compléter sa démarche en prenant en compte les autres impacts environnementaux de son entreprise ou de sa collectivité.
Il est également crucial pour toute organisation de se questionner sur les adaptations nécessaires aux conséquences actuelles et futures du changement climatique. L’utilisation complémentaire de méthodes comme l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) ou encore ACT Adaptation peut être intéressante pour mener une démarche de transition ambitieuse.
Le plan de transition : entreprendre des actions d’atténuation des émissions de GES
Grâce à la cartographie détaillée de ses flux d’émissions de GES, une organisation peut se fixer des cibles de réduction cohérentes avec l’objectif de neutralité carbone. Pour ce faire, une entreprise peut notamment choisir de s’inscrire dans l’initiative Science Based Targets en publiant des objectifs basés sur la science. Pour atteindre ses cibles, l’organisation élabore un plan de transition, en suivant, par exemple, la méthode ACT Pas à Pas.
Pour mesurer l’efficacité de ses actions de réduction des émissions, il est conseillé de réaliser un bilan carbone tous les ans. La méthode Bilan Carbone® peut notamment être utilisée comme un véritable outil de pilotage des GES. La méthodologie ACT Évaluation permet également de juger de la qualité d’une stratégie de transition bas carbone en réalisant un audit complet.
La contribution carbone : un outil complémentaire à la réduction des émissions
La diminution des émissions directes et indirectes liées à ses propres activités doit constituer la priorité de toute organisation. Mais il est également possible de participer à la transition en dehors de sa chaîne de valeur. C’est ce qu’on appelle la contribution carbone, ou compensation carbone. L’achat de crédits carbone permet de financer des projets de réduction des émissions ou encore des projets de séquestration carbone.
Pour réussir sa contribution carbone, l’ADEME propose de suivre ces 5 bonnes pratiques.
La qualité de ces opérations est toutefois très inégale et leur impact réel est parfois remis en question. C’est pourquoi il est indispensable de bien sélectionner les projets que l’on souhaite financer. De plus, une communication prudente et transparente est indispensable pour éviter toute accusation de greenwashing.
Allégations de neutralité carbone des entreprises : ce que dit la loi
L’ADEME estime que le concept de neutralité carbone n’a de sens qu’au niveau de la planète ou d’un État. Pourtant, en France, il est possible pour une entreprise de revendiquer un produit ou un service neutre en carbone. Les allégations de neutralité carbone sont cependant encadrées par la loi. Pour pouvoir déclarer qu’un produit ou un service est neutre en carbone, une entreprise doit :
- Réaliser un bilan GES intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service.
- Réaliser des opérations de compensation des émissions de GES résiduelles résultant du cycle de vie du produit ou du service.
Le manquement de la publication d’un bilan GES corroborant les allégations de neutralité carbone est sanctionné d’une amende de 20 000 € (personne physique) et de 100 000 € (personne morale). De plus, une allégation de neutralité fausse ou de nature à induire en erreur est considérée comme une pratique commerciale trompeuse.
Elle peut donc être sanctionnée de 2 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende pour une personne morale. Le montant de l’amende peut également être proportionnel aux avantages tirés par l’allégation de neutralité carbone trompeuse.
En conclusion : les objectifs de l’Accord de Paris sont-ils encore atteignables ?
L’étude des trajectoires de décarbonation actuelles dépeint un tableau assez pessimiste. La limitation du réchauffement climatique en dessous des 1,5 °C semble désormais quasiment inatteignable. Même la barre symbolique des 2 °C paraît difficile à ne pas dépasser, au vu des politiques climatiques en vigueur. Parvenir à la neutralité carbone au cours du siècle est cependant toujours possible. Mais dans plusieurs scénarios, le réchauffement climatique pourrait continuer à s’aggraver, même après 2100.
Il est important d’ajouter que certaines boucles de rétroaction positives irréversibles pourraient accentuer la libération de GES dans l’atmosphère et complexifier davantage l’objectif de neutralité carbone. On peut citer, par exemple, la fonte du permafrost, qui libérerait des quantités importantes de dioxyde de carbone et de méthane. À l’heure actuelle, nombre de ces scénarios sont encore incertains et il est difficile de faire des prédictions précises.
Que les objectifs de l’Accord de Paris soient atteints ou non, il est plus que jamais essentiel de rester mobilisés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans une ommunication de janvier 2025, le Centre commun de recherche européen rappelle qu’il reste de l'espoir, même pour les cibles les plus ambitieuses.
Cependant, des changements majeurs doivent avoir lieu d’ici à 2035 pour y parvenir. Le JRC avance plusieurs pistes d’action dans sa communication. La génération d’électricité bas carbone partout dans le monde ou encore la mise en place de puits de carbone artificiels importants en sont des exemples.