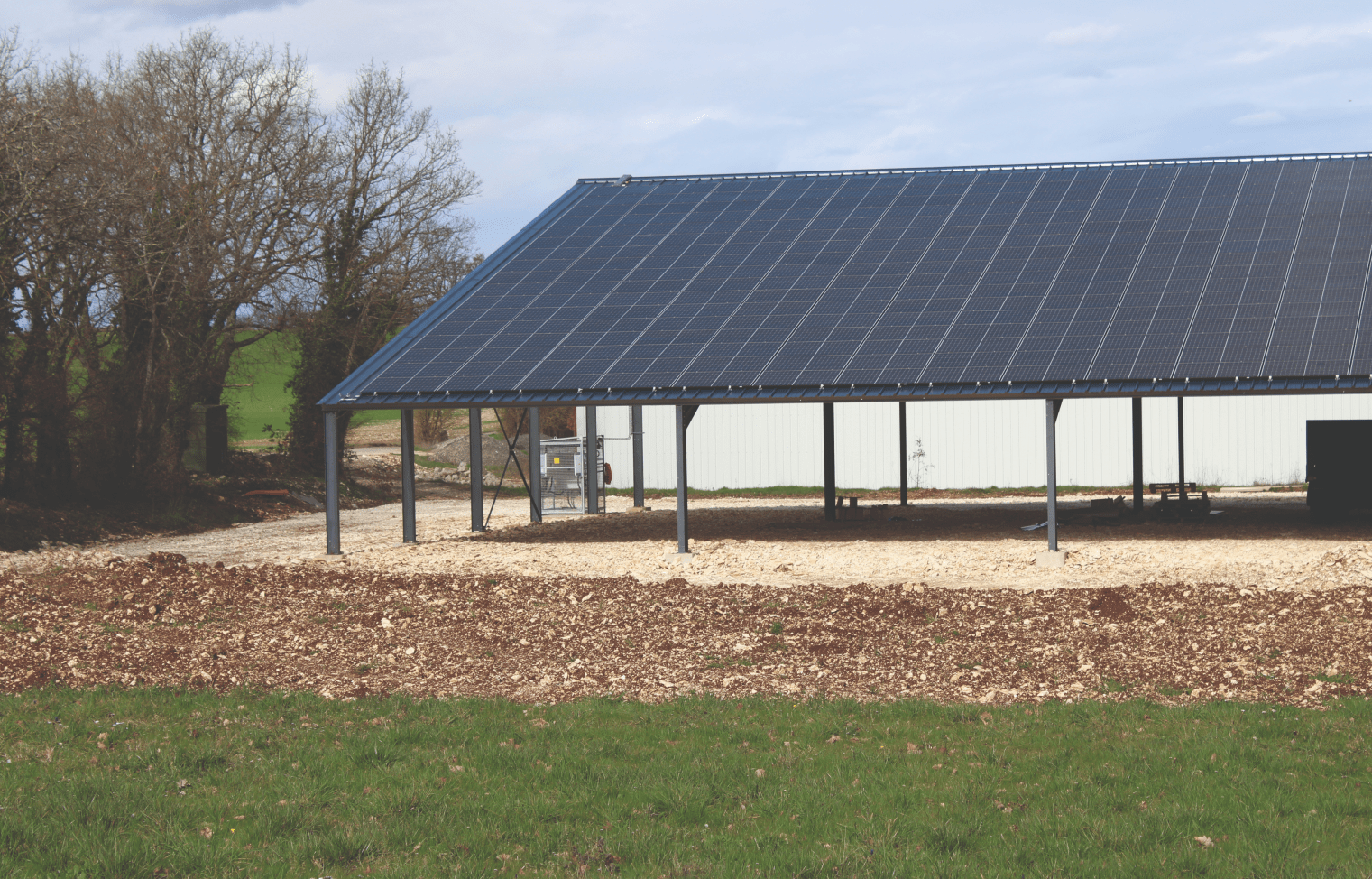Améliorer l’efficacité énergétique permet de réduire la consommation. Cette affirmation semble logique au premier abord, mais se heurte à un phénomène contre-intuitif. En raison du gain énergétique réalisé, le comportement du consommateur évolue, et il en résulte une consommation qui peut repartir à la hausse. Ce paradoxe bien réel porte le nom d’effet rebond.
Le concept n’est pas nouveau. Il s’inscrit dans une réflexion amorcée dès le 19e siècle et prolongée tout au long du 20e siècle, autour des limites de l’efficacité technique face aux usages réels. Malgré des avancées technologiques incontestables, la consommation d’énergie continue de croître dès lors que les comportements ne sont pas régulés.
Pour les entreprises et les acteurs publics qui investissent dans la transition énergétique, la compréhension de ce phénomène permet de porter un nouveau regard sur les actions mises en œuvre et d’en évaluer plus finement l’efficacité réelle.
Pilotez votre performance énergétique
EN RÉSUMÉ :
- Une technologie plus efficace peut entraîner une surconsommation.
- L’effet rebond peut être direct, indirect ou macroéconomique.
- Les comportements jouent un rôle central dans la performance réelle.
- Le suivi, la pédagogie et les nudges aident à limiter l’effet rebond.
Effet rebond : définition
L’effet rebond est un phénomène économique et comportemental qui apparaît lorsqu’une amélioration de l’efficacité énergétique entraîne paradoxalement une augmentation de la consommation.
Plus la technologie devient performante, moins elle coûte à l’usage, et plus elle est utilisée. Les économies d’énergie attendues sont alors partiellement ou totalement annulées.
Ce mécanisme est aussi connu sous le nom de paradoxe de Jevons, du nom de l’économiste britannique William Stanley Jevons. Dès 1865, celui-ci observe qu’à la suite de l’invention de la machine à vapeur de James Watt, bien plus économe que les versions précédentes, la consommation de charbon en Angleterre augmente au lieu de baisser. Ce constat contre-intuitif marque l’une des premières mises en lumière de l’effet rebond.
Plus d’un siècle plus tard, dans les années 1980, les économistes Khazzoom et Brookes reprennent cette idée à l’échelle contemporaine. Ils montrent que malgré les progrès réalisés en efficacité énergétique après les chocs pétroliers, la consommation d’énergie continue d'augmenter à l’échelle mondiale. La technologie, seule, ne suffit pas à inverser la tendance si les comportements ne sont pas maîtrisés.
Aujourd’hui, l’effet rebond représente un enjeu important de la transition énergétique. Qu’il s’agisse d’équipements domestiques, d’infrastructures publiques ou de systèmes industriels, les efforts d’optimisation énergétique perdent en efficacité réelle si les habitudes de consommation évoluent dans le mauvais sens.
Les différentes formes d’effet rebond
L’effet rebond se présente sous plusieurs formes qui renvoient à des comportements ou à des phénomènes différents. Mais dans tous les cas, ce sont les effets positifs de l’amélioration énergétique qui sont amoindris.
L’effet de rebond direct
Il s’agit de la forme la plus intuitive de toutes. Lorsque l’efficacité énergétique d’un équipement est améliorée, ce dernier est utilisé plus intensivement, ce qui augmente la consommation d’énergie nécessaire à son fonctionnement.
Par exemple, un promoteur adopte une technologie d’isolation thermique performante pour ses bâtiments tertiaires. Mais il choisit alors de construire avec plus de baies vitrées ou d’augmenter les volumes chauffés pour séduire les futurs locataires, ce qui compense une partie des économies prévues.
LE CHIFFRE HELLIO : 7%
Il s’agit, selon les bons gestes recommandés par l’Ademe, de la quantité d’énergie qu’un foyer peut économiser en réduisant la température de consigne du chauffage de 1 °C.
L’effet de rebond indirect
Cette forme de l’effet rebond est plus subtile. Elle correspond à une économie réalisée sur un poste, puis réinjectée dans un autre poste.
Une entreprise optimise l’isolation de ses entrepôts et réduit sa consommation électrique. Elle utilise les économies dégagées pour mettre en place une livraison express 24 h/24 avec des tournées plus fréquentes. Le confort client augmente, mais au prix d’un impact environnemental accru.
Ce transfert de consommation augmente l’empreinte carbone, alors que l’intention de base était contraire.
L’effet de rebond macroéconomique
À l’échelle de toute une économie, si une technologie permet l’augmentation de la productivité ou une baisse des coûts de production, elle favorise la croissance économique. Il en résulte une hausse de la consommation d’énergie.
Ce phénomène questionne le modèle économique dominant basé sur la croissance et l’optimisation.
Découvrez aussi : Comprendre l’intensité énergétique
Maîtrisez vos consommations sans effet rebond
Pourquoi l’effet rebond freine la transition énergétique ?
En théorie, les politiques d’efficacité énergétique ont pour but de réduire les consommations, d’améliorer les performances et de limiter les émissions. Mais en pratique, si l’effet rebond n’est pas anticipé, il existe un écart entre l’impact théorique de la mesure et son efficacité réelle.
Cet écart est d’autant plus problématique qu’il est souvent invisible dans les rapports : les consommations ne baissent pas autant que prévu, sans qu’on puisse attribuer cet écart à une cause technique. Ce décalage rend complexe l’évaluation des stratégies bas carbone.
Au-delà des usages individuels, l’effet rebond traduit un paradoxe économique plus profond. L’amélioration de l’efficacité réduit les coûts, ce qui favorise la diffusion massive des technologies. À l’échelle d’un marché, cela relance la demande, stimule la production, et entraîne une hausse globale de la consommation.
Dans ce contexte, l’efficacité seule ne suffit pas : elle doit être accompagnée d’une réflexion sur les usages, la sobriété énergétique et les limites structurelles du modèle actuel.
Comment limiter l’effet rebond ?
L’effet rebond nous démontre que la technologie seule ne suffit pas, et qu’il faut intégrer une dimension comportementale à toute démarche énergétique. Pour ce faire, plusieurs leviers sont envisageables.
Donner de la visibilité à l’impact des usages
L’ASTUCE HELLIO
Un simple affichage régulier de la consommation électrique peut faire toute la différence. L’étude TicElec, menée par le CNRS à Biot (Alpes-Maritimes), a montré que les foyers équipés de compteurs intelligents ou de capteurs connectés, et informés de manière continue sur leur consommation, ont réduit leur usage d’électricité de 23 % en moyenne.
Le suivi des consommations, via des compteurs intelligents ou des outils de monitoring, permet à chacun de prendre conscience de ses habitudes. La possibilité de comparer ses consommations avant et après des travaux d’amélioration énergétique, permet par exemple de renforcer l’engagement et de créer un lien direct entre l’efficacité énergétique et le comportement.
Agir sur les comportements via des « nudges »
Les « nudges » sont des petits coups de pouce visuels dont le but est d’inciter l’adoption de gestes sobres, en modifiant le comportement des individus de manière prévisible. Plutôt que de contraindre, ils permettent d’orienter les comportements par des signaux simples et non intrusifs :
- régler le chauffage à 19 °C et enfiler un pullover ;
- éteindre les équipement en veille ;
- ou encore éviter l’ouverture prolongée de fenêtres en hiver.
Une étude menée par Engie Impact en collaboration avec l'Université de Montpellier a démontré que l'utilisation de nudges, tels que des autocollants incitatifs et des messages de remerciement, a permis de réduire significativement la consommation d'énergie des utilisateurs ciblés.
Créer de nouveaux réflexes collectifs
Pour aller plus loin, certaines initiatives misent sur des formats ludiques et participatifs. Le projet européen GreenPlay en est un bon exemple.
Il a combiné le déploiement de compteurs intelligents avec un « serious game » (Apolis Planeta) destiné à sensibiliser les foyers à leur consommation énergétique.
Mené auprès de plus de 150 logements en France et en Espagne, le projet a permis d’analyser les comportements et de mesurer des évolutions concrètes, notamment une baisse des températures de chauffage en hiver.
Ces résultats confirment l’intérêt d’intégrer des approches interactives dans les stratégies de maîtrise de l’énergie. Jeux, challenges internes, ou encore feedback visuel sont autant de leviers qui renforcent l’engagement et favorisent l’adoption durable de nouveaux réflexes, aussi bien dans l’habitat que dans les entreprises.
Encadrez vos travaux par un contrat à performance garantie