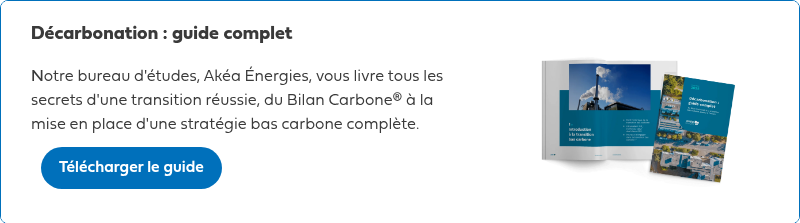Le 12 décembre 2023, la COP28 se terminait par une exhortation à la décarbonation, et plus précisément par un appel à s’éloigner des combustibles fossiles. Cette mesure est inévitable, selon António Guterres, le chef de l’ONU, si nous souhaitons réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et limiter la hausse de température globale à 1.5°C.
En France, le bâtiment représente presque la moitié de la consommation énergétique totale, et génère 18 % des émissions de GES, comme le souligne l’ADEME dans son communiqué du 19 mars 2024. Dans ce scénario, le principal incriminé est le poste de chauffage. En effet, 47 % des ménages français ont recours à un combustible fossile pour se chauffer, selon l’enquête logement 2020 du SDES.
C’est pourquoi le concept de chauffage décarboné devient une priorité dans la course à la réduction des émissions de GES. Après un rappel sur les enjeux de la décarbonation du chauffage en France, nous verrons les alternatives de chauffage décarboné les plus pertinentes, ainsi que les dispositifs financiers disponibles.
• La COP28 a conclu en appelant à s’éloigner des combustibles fossiles pour limiter le réchauffement à 1,5 °C.
• En France, le chauffage représente 81 % des émissions CO2 dans le secteur résidentiel, ce qui tend à prioriser sa décarbonation.
• Les alternatives décarbonées incluent les pompes à chaleur (aérothermie et géothermie), les radiateurs électriques modernes, les réseaux de chaleur urbains et le chauffage au bois durable.
• Des aides financières comme MaPrimeRénov’ et le Coup de pouce Chauffage (particuliers) ainsi que le Fonds Chaleur et le Coup de pouce Chauffage tertiaire (professionnels) facilitent la transition.
• Hellio accompagne particuliers, entreprises et collectivités dans la mise en œuvre de solutions de chauffage peu carbonées pour accélérer la transition énergétique.
Le chauffage est un poste critique pour les émissions de CO2 en France
Pour le domaine du bâtiment résidentiel, comme pour le domaine du bâtiment tertiaire, réduire les besoins de chauffage et décarboner les systèmes de chauffage existants sont des enjeux considérables pour réduire l’empreinte carbone du bâti.
Dans cette optique, l’attention se porte en priorité sur les systèmes à combustion de gaz et de fioul, qui représentent à eux seuls 64 % et 28 % des émissions de GES dans le résidentiel (données recueillies en 2018).
Dans le domaine du bâtiment résidentiel en France, 81 % des émissions de dioxyde de carbone sont le fait du chauffage, contre 12 % pour l’eau chaude, et 7 % pour la cuisson. Ces données sont consultables sur le portail du gouvernement lié à l’environnement.
Le contexte français de décarbonation du chauffage
En France, la stratégie de décarbonation du chauffage peut compter sur un mix électrique très peu carboné, grâce à la prédominance de l’énergie nucléaire, et dans une moindre mesure aux barrages hydroélectriques, au solaire et à l’éolien.
Hors périodes de pointe, l’électricité française consomme peu de combustibles fossiles, et peut être qualifiée d’électricité décarbonée. En effet, on lui attribuait en 2018 un contenu carbone moyen de 57 g CO2/kWh, ce qui est 6 fois moins que la moyenne européenne se situant à 350 g CO2/kWh.
Ainsi, les chauffages électriques dernière génération, et les pompes à chaleur performantes, s’imposent comme d'excellente solutions d’électrification des usages. Cette électrification, lorsqu’elle repose sur une production d’électricité bas carbone, constitue un levier majeur de décarbonation du chauffage sur le territoire français.
Le chauffage peu carboné repose sur l’utilisation d’énergies primaires à faible intensité carbone, telles que le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien, le solaire, le biogaz ou encore la récupération de chaleur fatale. Ces sources permettent de produire une électricité plus vertueuse, ensuite utilisée par les équipements de chauffage. D’autres alternatives, comme les réseaux de chaleur vertueux (alimentés en grande partie par des énergies renouvelables ou de récupération), ou encore la combustion du bois dans certaines conditions, peuvent également contribuer à cette transition. Mais il faut rester conscient qu’un chauffage 100 % décarboné n’est pas réalisable en pratique.
En effet, les pompes à chaleur utilisent des gaz frigorigènes dont les potentielles fuites peuvent libérer des GES. La fabrication des équipements de production de chauffage n’est pas dépourvue d’énergie grise. En outre, la combustion du bois émet du CO2 et plusieurs autres polluants. Nous parlons donc de chauffage décarboné, mais sous-entendons en réalité qu’il est peu carboné.
Les impacts CO2 des différentes sources de chauffage
Toutes les sources de chauffage ne sont pas égales face aux émissions de CO2. Le tableau suivant nous présente comme une évidence les pistes d’amélioration prioritaires :
|
Type de chauffage |
Facteur d’émission CO2 (g/kWh) |
|
Chauffage au fioul |
~300–325 g CO2/kWh de chaleur utile |
|
Chauffage au gaz naturel |
~200–230 g CO2/kWh |
|
Chauffage électrique (résistif direct) |
~50–80 g CO2/kWh (en moyenne, ~57 g CO2 en 2018) |
|
Pompe à chaleur (PAC) |
~10–30 g CO2/kWh de chaleur restituée |
Sources : connaissancedesenergies.org, edf.fr
Quelles sont les alternatives de chauffage décarboné en France ?
Comme nous l’avons vu, le patrimoine nucléaire de France fait la part belle aux systèmes de chauffage électriques. Les pompes à chaleur performantes ainsi que les chauffages électriques modernes sont les principaux bénéficiaires de cette nécessité de décarbonation française. Mais d’autres modes de chauffage, comme les réseaux de chaleur ou le chauffage au bois, sont également des solutions pertinentes.
Les pompes à chaleur (PAC)
Pour assurer le besoin en chauffage, les pompes à chaleur aérothermiques puisent l’énergie dans l’air extérieur. Les pompes à chaleur géothermiques, pour leur part, extraient l’énergie du sol ou de la nappe phréatique via une sonde géothermique enfouie verticalement ou horizontalement dans le sol.
Les pompes à chaleur ont besoin d’électricité pour fonctionner, mais affichent des rendements très supérieurs aux systèmes de chauffage classiques électrique, au fioul ou au gaz. Pour les PAC géothermiques, les meilleurs coefficients de performance saisonniers (SCOP) peuvent approcher les 5. Cela signifie qu’elles produisent 5 fois plus d’énergie de chauffage qu’elles ne consomment d’électricité.
Pour les PAC aérothermiques, ce coefficient de performance saisonnier se situe le plus souvent entre 3 et 4.
Ainsi, le potentiel des PAC en termes de réduction des émissions de CO2 est 3 à 5 fois plus important qu’un système de chauffage électrique classique ou fossile.
Dans certains cas, une solution intermédiaire consiste à associer une pompe à chaleur à une chaudière gaz à haute performance via un système de cogénération. Cette combinaison, souvent nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, permet de produire à la fois de la chaleur et de l’électricité tout en réduisant les émissions par rapport à un chauffage 100 % gaz. C’est une option très pratique pour amorcer une transition progressive vers un chauffage décarboné.
Les radiateurs électriques de dernière génération
Les radiateurs électriques de nouvelle génération correspondent aux modèles à chaleur douce, à inertie fluide ou sèche, ou encore aux panneaux rayonnants intelligents. En comparaison des anciens systèmes, ils apportent plus de confort et régulent mieux. En effet, ils ont une meilleure inertie thermique, disposent de thermostats électroniques, fonctionnent sur programmation horaire, et peuvent détecter les ouvertures de fenêtre.
Les économies d’énergie sont substantielles, cependant ils sont toujours confrontés à leur principe intrinsèque, à savoir l’effet Joule. Il en résulte que la production d’1 kWh de chaleur nécessite la consommation d’1 kWh d’électricité, en faisant l’hypothèse d’un rendement de 100%. Ce qui est incomparable aux rendements que proposent les pompes à chaleur.
En France, où le nucléaire règne en maître, les radiateurs électriques présentent donc un bilan carbone positif en comparaison des systèmes fossiles.
Cependant, leur utilisation intense lors de la saison froide peut impliquer le recours à des centrales à gaz ou au fioul en complément du nucléaire, et donc impacter négativement la décarbonation du chauffage.
Les réseaux de chaleur urbains
Le réseau de chaleur urbain est un système de chauffage centralisé au niveau d’un quartier ou d’une ville. Quelques unités de production alimentent des canalisations isolées qui distribuent de l’eau chaude pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire vers divers types de bâtiments : logements, bâtiments tertiaires publics ou privés, sites industriels ou encore bâtiments agricoles.
Cette mutualisation permet une optimisation du rendement global au niveau d’un nombre limité d’unités de production. Mais elle permet également de faire appel à des énergies qui sont souvent difficiles à exploiter au niveau individuel, comme la biomasse, la géothermie, ou la récupération de chaleur industrielle aussi appelée chaleur fatale.
Toujours selon cette enquête de la Fedene, les émissions de CO2 des réseaux de chaleur urbaine sont passées de 200 gCO2 ACV/kWh en 2012 à 112 gCO2 ACV/kWh en 2023, ce qui représente deux fois moins que le contenu carbone du gaz et ses 227 gCO2ACV/kWh.
Pour aller plus loin, le site france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr permet de consulter la cartographie de tous les réseaux de chaleur en France, avec des informations détaillées sur leur mix énergétique, leur taille et leur niveau de performance environnementale.
Les réseaux de chaleur urbains jouent un rôle clé dans la décarbonation. Alimentés à 66,5 % par des énergies renouvelables et de récupération, ils exploitent notamment la chaleur fatale (30 %) et la biomasse (26 %), selon la Fedene.
Le chauffage au bois
Le bois est une source d’énergie renouvelable dans la mesure où la ressource est gérée de manière durable. En effet, utiliser le bois de forêts bien gérées et replantées assure que le CO2 émis à la combustion sera réabsorbé par les nouveaux arbres. Ce mode de fonctionnement permet de se rapprocher de la neutralité carbone sur le cycle de vie du bois.
Au niveau climatique, le bois présente un impact très inférieur aux énergies fossiles. Selon un rapport de l’ADEME de 2022, la production d’1 kWh de chaleur avec du bois émet seulement 11 à 30 g équivalent CO2, environ 7 fois moins que le gaz naturel.
Le bois local certifié est donc l’une des options les plus vertueuses pour se chauffer, pourvu que la ressource soit exploitée de façon à ne pas entamer le stock de carbone des forêts. Cependant, ce beau tableau est entaché par les polluants atmosphériques émis à la combustion. La fumée de bois contient en effet des particules fines, du monoxyde de carbone, ou encore des composés organiques volatils.
Les appareils modernes, labellisés Flamme Verte, sont bien plus propres que les anciens poêles ou que les cheminées ouvertes. La décarbonation du chauffage au bois peut donc passer par un remplacement d’appareils anciens, et par la propagation de bonnes pratiques d’entretien.
Le solaire thermique
Le solaire thermique est également une solution de chauffage renouvelable et décarbonée. Cette technologie exploite l’énergie du soleil au moyen de panneaux qui convertissent le rayonnement solaire en chaleur pour produire de l’eau chaude et/ou alimenter un système de chauffage.
On lit dans ce document de l’ADEME qu’un chauffe-eau solaire peut assurer entre 50 et 80 % des besoins annuels en eau chaude sanitaire, selon l’ensoleillement de la région. Une bonne installation peut fournir entre 400 et 500 kWh de chaleur par mètre carré de capteur chaque année, selon ce rapport de l’Agence Qualité Construction.
La chaleur renouvelable ainsi produite remplace d’autant la consommation d’énergies fossiles et réduit fortement l’empreinte carbone.
Par ailleurs, le solaire thermique est une filière éprouvée et durable. On peut lire dans le rapport de l’ADEME précédemment cité qu’une installation bien dimensionnée peut fonctionner plus de 20 ans avec une maintenance minimale. Cela en fait un choix fiable pour décarboner le chauffage de bâtiments de grande taille.
La sobriété énergétique : un autre levier de décarbonation
Trop souvent réduite à la seule question du changement d’équipement, la décarbonation du chauffage passe aussi par la sobriété énergétique. Cette approche vise à réduire la consommation d’énergie à la source. Elle repose sur deux piliers complémentaires.
Le premier concerne les usages :
- éviter de chauffer les locaux inoccupés ;
- abaisser légèrement la température de consigne (chaque degré compte) ;
- programmer les systèmes de chauffage en fonction de l’occupation réelle ;
- ou encore réparer les thermostats défectueux.
Ce sont des gestes simples, peu coûteux à mettre en œuvre, mais qui peuvent générer des économies substantielles.
Le second pilier est l’optimisation passive du bâti. Une bonne isolation, une ventilation adaptée, l’étanchéité à l’air, mais aussi l’orientation des pièces ou le choix de matériaux performants permettent de réduire durablement les besoins de chauffage.
Associée aux solutions techniques de décarbonation, la sobriété énergétique permet d’amorcer une transition plus rapide, moins coûteuse et souvent plus efficace à court terme. C’est aussi un signal fort en matière de responsabilité énergétique, attendu des acteurs publics comme privés.
Quelles sont les aides disponibles pour aider à la décarbonation ?
Les particuliers, comme les professionnels, peuvent bénéficier d’aides ou de dispositifs financiers visant à faciliter la décarbonation du pays.
Les aides à la décarbonation pour les particuliers
MaPrimeRénov’
L’objectif de MaPrimeRénov’ est la rénovation des logements privés en vue d’améliorer leur performance globale. Cette aide vise notamment à soutenir le remplacement des systèmes de chauffage fossiles par des solutions décarbonées. Elle est accordée si et seulement si les travaux sont réalisés par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
MaPrimeRénov’ est accessible pour les propriétaires de logements de plus de 15 ans, en résidence principale. La prime est modulée selon les revenus des ménages. Un ménage très modeste peut prétendre, sous certaines conditions, à un financement de 90 % du coût des travaux, plafonné à 70 000 €. Ceci dans le cadre d’une rénovation d’ampleur (bouquet de travaux).
La prime pour l’installation d’une PAC air-eau seule varie entre 3 000 et 5 000 €. Quant aux pompes à chaleur géothermiques, la prime pour l’installation peut monter jusqu’à 11 000 €.
Coup de pouce Chauffage
L’aide Coup de pouce Chauffage vise à inciter le remplacement des anciennes chaudières au fioul domestique, au charbon, ou au gaz, par des solutions plus propres. Ouvertes à tous les particuliers, qu’ils soient locataires ou propriétaires d’une maison individuelle, elle requiert cependant que la construction date de plus de 2 ans.
La prime est cumulable avec MaPrimeRénov’ et dépendante des revenus du ménage. Elle monte par exemple à 4 000 € pour un ménage modeste choisissant l’installation d’une PAC air-eau. Dans le cas d’une pompe à chaleur géothermique ou d’un système solaire combiné, c’est même 5 000 € pour tous.
Citons aussi : l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), la TVA à taux réduit de 5,5 %, ou encore les aides locales (caisse de retraite, région…).
Les aides à la décarbonation pour les professionnels
Fonds Chaleur
Géré par l’ADEME depuis 2009, le Fonds Chaleur incite à l’installation de systèmes de production de chaleur vertueuse tels que la biomasse, la chaleur fatale, ou encore la géothermie. En 2024, ce ne sont pas moins de 820 M€ de subventions qui ont été alloués.
Le montant de cette aide financière peut couvrir entre 30 % et 60 % des coûts éligibles, selon l’énergie choisie.
Coup de pouce Chauffage tertiaire
Comme pour les particuliers, le Coup de pouce Chauffage tertiaire incite les propriétaires de bâtiments tertiaires ou d’immeubles résidentiels collectifs à remplacer les chauffages fonctionnant aux énergies fossiles, par des solutions propres.
Cette aide est destinée aux bâtiments de grande taille, et vise en priorité à financer le raccordement à un réseau de chaleur vertueux, lorsque cela est techniquement et économiquement possible. En l’absence de solution de raccordement adaptée, l’aide permet alors de soutenir l’installation de systèmes de chauffage performants en remplacement des chaudières au fioul ou au gaz.
Par exemple, pour un bâtiment tertiaire, l’installation d’une PAC air-eau en remplacement d’une chaudière gaz permet de multiplier par 3 le montant des certificats d’économies d’énergie (CEE). Ce même coefficient s’applique à une chaudière biomasse, tandis qu’il passe à 4 si la chaudière remplacée fonctionnait au fioul.
C’est la quantité de chaleur et de froid distribuée via les réseaux de chaleur en 2022. Via son appel à projets « une ville, un réseau », l’ADEME affiche son ambition de passer à 40 TWh d’ici 2030, et propose des aides spécifiques aux villes de moins de 50 000 habitants.
BPI, Ademe, subventions européennes, aides locales…
Enfin, de nombreuses aides sont versées par des structures telles que la BPI, l’Ademe (en plus de Fonds Chaleur), les collectivités ou encore l’Union européenne. Il faut bien souvent manifester son intérêt lors des appels à projets, avant l’échéance. Le pôle Subventions de Hellio peut vous éclairer sur le sujet !
Comment Hellio peut accompagner votre démarche de décarbonation ?
Depuis plus de 15 ans, Hellio et son bureau d’études Akéa Énergies agissent en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Conscients que la décarbonation représente le défi climatique du siècle, nos experts accompagnent votre organisation dans la mise en œuvre de la méthode Bilan Carbone®.
Cette méthode, proposée par l’ADEME, propose la classification des émissions de GES selon 3 scopes. Le scope 1 concerne les émissions de GES produites directement par l’entreprise, le scope 2 y ajoute les émissions indirectes liées à l’énergie consommée sur le site, et le scope 3 y inclut toutes les autres émissions indirectes.
Hellio vous apporte également son expertise en financement des projets d’efficacité énergétique et de décarbonation, en Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et en maîtrise d'œuvre.